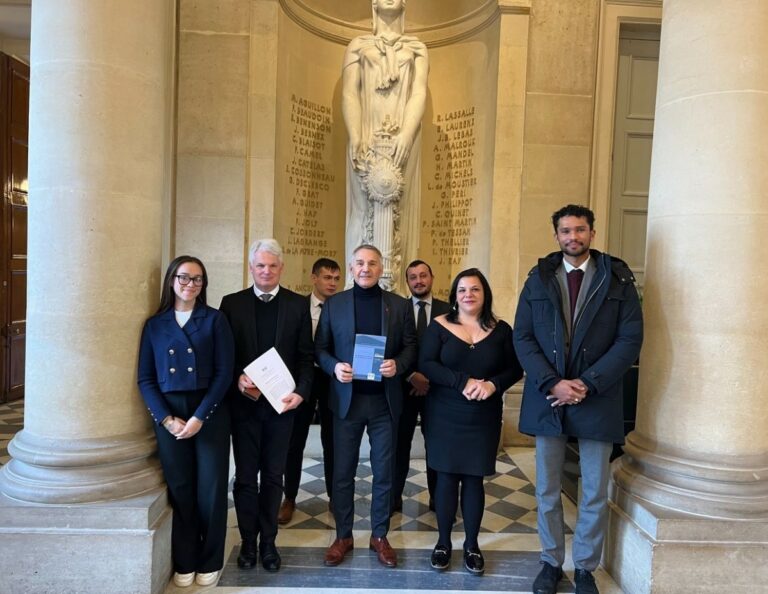RETOUR SUR LES CONCLUSIONS DU BEAUVAU DES POLICES MUNICIPALES ET DU BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE : DES ANNONCES EN DEMI-TEINTE POUR FRANCE URBAINE
À l’occasion de cette rentrée, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Bruno RETAILLEAU et le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, François-Noël BUFFET, ont présenté les conclusions de deux cycles de concertation engagés depuis plus d’un an, à savoir le Beauvau des polices municipales et le Beauvau de la sécurité civile. En raison du contexte politique, le débouché législatif de ces projets gouvernementaux, théoriquement prévu à l’automne, reste dans l’expectative. Il n’en reste pas moins que les déclarations ministérielles comportent des annonces jugées contrastées par France urbaine.

Beauvau des polices municipales : une copie finale mitigée pour l’association des grandes villes, agglomérations et métropoles de France
Pour l’heure, le projet de loi issu du Beauvau des polices municipales doit encore être présenté en Conseil des ministres et est actuellement soumis aux différentes instances consultatives dont le Conseil d’Etat et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le ministre de l’Intérieur et le ministre auprès du ministre de l’Intérieur n’en ont pas moins évoqué les principales avancées pour les polices municipales :
- L’extension des prérogatives judiciaires des polices municipales à neuf amendes forfaitaires délictuelles, en excluant, comme le soutenaient plusieurs associations du bloc communal, la qualité d’officier de police judiciaire (par modification de l’article 15 du Code de procédure pénale) : vente à la sauvette, vol simple, tags et graffitis, obstruction à la circulation, conduite sans permis, occupation illicite de hall d’immeuble, outrage sexiste et sexuel aggravé, vente d’alcool aux mineurs, usage de stupéfiants ;
- La possibilité pour les policiers municipaux de consulter les fichiers nécessaires à l’exercice de leurs missions (sans que le texte n’en précise toutefois les modalités ni les fichiers concernés) ;
- L’extension du cadre du relevé d’identité ;
- La facilitation du dépistage d’alcool et de stupéfiants ;
- L’ouverture de l’expérimentation des drones, pour une durée de cinq ans ;
- La création d’un numéro d’identification unique pour les policiers municipaux.
Si France urbaine tient à saluer ces évolutions qui vont dans le sens d’une amélioration de l’action des policiers municipaux, la copie globale reste néanmoins insuffisante pour satisfaire pleinement les attentes des maires et celles des agents sur le terrain.
Plusieurs propositions portées de longue date par les élus locaux, par l’intermédiaire de France urbaine notamment, semblent, en effet, écartées à ce stade :
- L’intégration des arrêtés des maires aux terminaux PVe des agents (procès-verbal électronique) qui reste pourtant une demande latente pour fluidifier l’action des agents ;
- La possibilité pour les policiers municipaux d’exercer en civil afin de faciliter la constatation de certaines incivilités ;
- La possibilité pour les policiers municipaux d’opérer, au-delà des relevés, des contrôles d’identité, dans les mêmes conditions que les forces de l’ordre qui y sont aujourd’hui habilitées, dans la mesure où les policiers municipaux sont de plus en plus engagés sur des missions conjointes avec la police ou la gendarmerie nationale (ex : patrouilles aux abords des sites sensibles).
- La rétrocession, au profit des collectivités locales, du produit des amendes dressées par les policiers municipaux, essentiellement capté par l’Etat aujourd’hui dans un souci d’équité budgétaire.
Il est, par ailleurs, prévisible que l’extension des compétences des policiers municipaux limitée à neuf amendes forfaitaires délictuelles – avec, au demeurant, un rôle très directif confié au Procureur de la République dans ce projet de loi – génère un effet déceptif pour les édiles désireux de donner davantage de prérogatives à leurs policiers municipaux. D’autant plus en tenant compte des délais, estimés entre deux et cinq ans par le ministère de l’Intérieur, pour la mise en œuvre des évolutions prévues par ce texte.
S’agissant en outre du volet social de ce texte, il est à craindre un rejet de ce projet par une partie des organisations syndicales au regard de la modicité des mesures sur ce plan, qui ne concerneraient tout au plus que des mesures de reconnaissance symbolique. L’hypothétique projet de loi aborde, en revanche, la suppression de « l’engagement de servir » des agents pour une durée de trois ans, créée par la loi “Sécurité globale”, et qui avait suscité une vive opposition syndicale, au profit du remboursement des frais de formations des policiers municipaux directement entre collectivités. Le motif avancé par les rédacteurs de ce texte étant que cette obligation est insuffisamment appliquée au niveau local et préjudiciable à l’attractivité. Cet argument, plus que contestable à l’épreuve de la pratique qu’en font les différents membres de France urbaine, masque en réalité une concession faite aux organisations syndicales à défaut de concrétisation du volet social du Beauvau. De surcroit, elle encourage, sinon risque d’accroitre davantage encore, la concurrence néfaste entre services de police municipale pris dans l’étau du “mercato des PM”, au détriment de ceux les moins bien dotés. C’est pourquoi France urbaine a défendu avec la Coordination des employeurs territoriaux (CET) un amendement de maintien du mécanisme d’engagement de servir lors de l’examen du projet de loi en CSFPT le 17 septembre.
France urbaine prend acte des conclusions du Beauvau de la sécurité civile, mais exprime son regret de ne pas avoir été associée à cette concertation.
Ce travail, qui doit aboutir à un projet de loi, met en lumière des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre modèle français de sécurité civile et pour la soutenabilité du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Un diagnostic partagé, mais des propositions de financement qui interrogent
Le rapport souligne, à juste titre, la fragilité croissante du modèle actuel de sécurité civile face à l’évolution des risques (changement climatique, vieillissement de la population, multiplication des incendies, enjeux sanitaires) et à la sur-sollicitation opérationnelle des SDIS. Il rappelle également la nécessité de réinterroger le panel de ressources des SDIS, dont les budgets sont tout à la fois très conséquents (6,7 milliards d’euros), fragiles et trop souvent peu lisibles , notamment en ce qui concerne les clés de répartition des contributions entre les différents acteurs.
Pour autant, France urbaine émet des réserves sur les pistes avancées en matière de financement. L’accroissement de la contribution du bloc communal, notamment celle des métropoles et grandes agglomérations, est à la fois injuste et discutable :
- L’échelon communal est, de fait, le premier lieu d’exercice de la sécurité civile (prévention, planification des plans communaux de sauvegarde, gestion des crises locales), sans bénéficier, pour autant, des moyens financiers correspondants ;
- La vision visant à mettre à profit les métropoles, évoquée dans le rapport (au motif d’une évolution de la démographie dans ces territoires qui accentue la mobilisation des SDIS), méconnaît, par ailleurs, la réalité très hétérogène d’une métropole à l’autre, et reviendrait à instaurer un niveau de service des SDIS différencié dans un même département ;
- Enfin, le rapport ne prend pas en compte la progression constante de l’effort financier des communes et intercommunalités dans le financement des SDIS, ni leur engagement volontaire au-delà du plafonnement légal de l’inflation (via des subventions d’investissement ou la mise à disposition de terrains viabilisés, par exemple)
Dans ce contexte, France urbaine appelle à une réforme du mode de financement des SDIS plus juste et équitable
Pour France urbaine, toute réforme de notre modèle de sécurité civile doit reposer, en effet, sur trois principes :
- Clarification de la gouvernance des SDIS, afin de garantir une gestion transparente ;
- Révision des modalités de financement, qui ne saurait reposer de façon accrue sur les communes et intercommunalités, déjà fortement mobilisées ;
- Responsabilité renforcée de l’État, les enjeux dépassant les seules collectivités locales.
France urbaine plaide ainsi pour une modernisation des ressources existantes (actualisation de l’assiette de la TSCA, mécanismes de péréquation entre collectivités, reconnaissance de la « valeur du sauvé »), le développement des pactes capacitaires et un soutien accru de l’État aux investissements structurants.
Poursuivre le dialogue avec l’État et le Parlement
France urbaine s’inscrira pleinement dans la suite des travaux engagés pour défendre un modèle de sécurité civile à la fois robuste, solidaire et soutenable. La réforme à venir doit garantir la pérennité des SDIS, au bénéfice de toutes et tous, sans fragiliser davantage les finances locales.