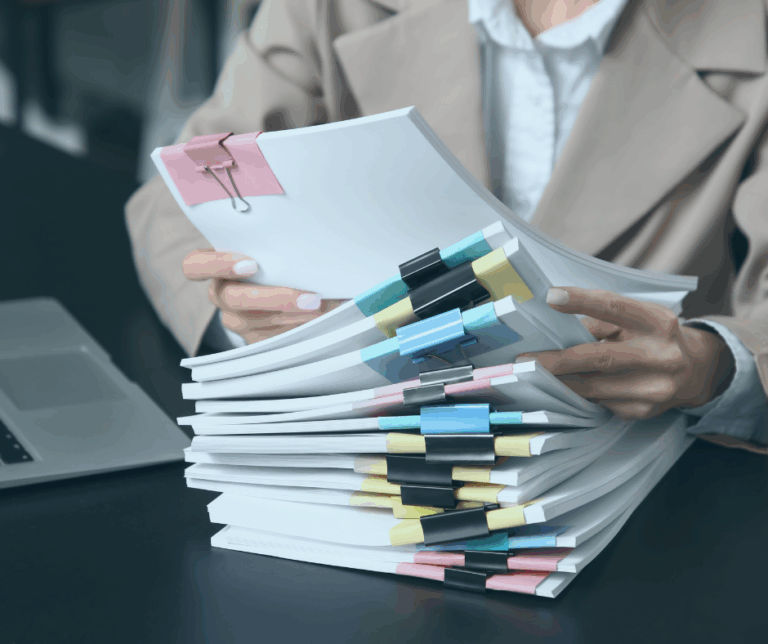LANCEMENT DU PROGRAMME POPSU TRANSITIONS À NANTES : VERS LA MÉTROPOLE DES INTERDÉPENDANCES ET DES COOPÉRATIONS
Le 21 mars 2024 s’est tenu à Nantes le Forum de lancement du nouveau programme « POPSU Transitions ». Prenant le relais du précédent programme « POPSU métropoles », ce nouveau cycle réunit 23 plateformes, dont certaines interterritoriales, autour de 50 axes de recherche.

Une dynamique essentielle à la justesse de l’action publique : comme l’a rappelé Johanna Rolland, présidente de France urbaine, en ouverture du forum de lancement, « tisser des liens entre la recherche et les collectivités est essentiel. Nous gagnons tous en intelligence et en capacité de coopération collective ». Une capacité de coopération rendue plus nécessaire que jamais à l’heure où la raréfaction des ressources, naturelles ou financières, rend la négociation interterritoriale à la fois plus vitale et difficile. Et un rendez-vous attendu avec impatience et enthousiasme par les élus et services des 23 plateformes !
« Tisser des liens entre la recherche et les collectivités est essentiel. Nous gagnons tous en intelligence et en capacité de coopération collective. Johanna Rolland
Transition : un « état de départ » connu, mais un « état d’arrivée » qui peine encore à faire l’objet d’un récit collectif mobilisateur
Face à la sédimentation des crises (économique, écologique ou géopolitique), il est exigé de chacune et de chacun, dans ses responsabilités (élu, chercheur, professionnel territorial, citoyen), la contribution concrète et urgente à la reconstruction d’un nouveau récit collectif. Une urgence martelée par Marie-Christine Jaillet, coordinatrice du collectif des responsables scientifiques nationaux du programme, en ouverture du Forum. Car si la transition exige un « état de départ » que les diagnostics ne manquent pas d’éclairer sous le prisme de l’urgence écologique et sociale, c’est « l’état d’après » qui reste aujourd’hui incertain.
Planification écologique : reconnaître la part, et donc la place, des territoires urbains
Cet « état d’après » résultera pourtant de la mobilisation de toutes et de tous, comme l’a rappelé Xavier Desjardins, professeur d’urbanisme et d’aménagement de l’espace au sein de l’UFR de géographie et d’aménagement de Sorbonne Université : or les scènes de dialogue, de mutualisation et de gouvernance actuelles ne facilitent pas la capacité de chaque territoire à identifier, en s’articulant dans un espace collectif, sa responsabilité propre dans l’atteinte des objectifs collectifs. Et donc sa place « dans une souveraineté écologique verte ».
Trois défis majeurs restent à relever :
- faire de la coopération un projet global : l’échelon local, et notamment intercommunal, est de fait en situation d’animer « tout seul » des coopérations qui de fait restent très sectorielles, sans réel soutien de l’État ou des régions : l’exercice n’a par exemple jamais été fait de consolider au niveau national les objectifs des SRADDET, qui pourtant forment une trajectoire nationale,
- la décentralisation n’est plus tant un enjeu de territorialisation de l’État-providence que « d’agrégation négociée » des contributions de chacune et chacun. Xavier Desjardins a ainsi appuyé les propos de Johanna Rolland, qui témoignait peu avant de la nécessité d’adapter le logiciel décentralisateur des années 80 à l’irruption de l’urgence climatique, et donc au renforcement des capacités de réponse et d’anticipation territoriales ;
- la rénovation de la relation entre l’État et les territoires, dans une logique d’aller-retours perpétuels.
« La prochaine étape de décentralisation doit être au service de la transition écologique. Nos intercommunalités doivent être autorités organisatrices de la transition écologique. Et le modèle de financement de l’action publique locale doit évoluer en fonction de cette nouvelle organisation ». Johanna Rolland
Anne Clerc, cheffe du pôle territoires au Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), a ainsi présenté la démarche mise en place sous le pilotage d’Antoine Pellion : l’identification d’une trajectoire de baisse de 55 % des émissions d’ici à 2030, qui se traduit en leviers d’action actuellement mis en débat dans le cadre des COP régionales.
Johanna Rolland, tout en reconnaissant le caractère innovant et, pour tout dire, inédit du diagnostic posé par le SGPE, et la responsabilité immense qu’elle induisait pour les territoires urbains, a toutefois mis en garde sur la capacité de l’État à faire atterrir cette démarche dans un dialogue réel avec le monde urbain, qui porte une responsabilité particulière en matière d’émissions (deux tiers) mais aussi de concentration des vulnérabilités sociales (deux tiers). Or aujourd’hui, l’échelon métropolitain n’est, de fait, pas identifié comme scène de négociation incontournable avec l’État. Et ses spécificités et urgences écologiques courent le risque d’être diluées dans une analyse à l’échelle régionale, voire départementale.
Alliance des territoires : « négocier des restrictions » pour partager des solutions
La grande innovation du programme « POPSU Transitions » est de s’ouvrir à de nouvelles plateformes interterritoriales, comme par exemple le pôle métropolitain du Sillon Lorrain. De fait, aucun aspect de la transition – ressource en eau, systèmes alimentaires territoriaux, protection du sol… – ne peut faire l’économie d’un dialogue interterritorial et de la conscience d’une responsabilité partagée. Sans toutefois, comme l’a indiqué Marie-Christine Jaillet, pécher par excès d’ingénuité ou de naïveté. La coopération et la réciprocité ne gomment pas des situations d’asymétrie de fait entre réalités territoriales, qu’il faut donc articuler et dépasser.
Johanna Rolland a aussi rappelé que cette asymétrie était réciproque : alors que les villes accueillent près de 70 % des personnes en situation de pauvreté, il faudrait par exemple que les coopérations s’élargissent aussi aux enjeux de logement social (hors des villes), sans parler de l’accueil des migrants.
Frédérique Bonnard Le Floc’h, vice-présidente de Brest Métropole, coprésidente de la Commission Alliance des territoires de France urbaine, a également appelé à changer de focale et à lutter contre toute forme de populisme ou de séparatisme territoriale. À Brest, la métropole a très vite pris conscience que « la puissance vient de la fragilité des interdépendances reconnues » dans un monde rendu violent par la raréfaction de ressources qui remettent en cause les différentes formes du vivant.
« À Brest, la métropole a très vite pris conscience que la puissance vient de la fragilité des interdépendances reconnues. » Frédérique Bonnard Le Floc’h
Face à ces constats, nous n’avons pas encore réussi à construire des scènes de dialogue et de négociation avec l’État : la notion de contrat a été vidée de sa substance d’engagements réciproques et financièrement assumés, et l’approche par strate de collectivité ne permet pas de penser les systèmes. Alors que le mantra de France urbaine a toujours été « du projet partagé au contrat qui engage », les Contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) n’ont, à ce stade, donné d’avancées que sur le projet partagé.
« La notion de contrat a été vidée de sa substance. » Frédérique Bonnard Le Floc’h
Un propos partagé par Marc Dumont de l’Université de Lille, qui s’est interrogé sur les nouvelles scènes de l’interterritorialité. En matière alimentaire notamment, les espaces de construction n’existent pas face à la complexité inhérente à la structuration de filières. Jérémy Camus, vice-président de Lyon Métropole, a insisté sur le caractère modélisant des coopérations alimentaires. La métropole a ainsi élargi son action à 50 km autour de la métropole, pour contribuer à construire de nouvelles stratégies et perspectives collectives en matière alimentaire.
Marc Dumont a également placé au cœur des échanges la capacité à construire et partager de la donnée pour identifier les trajectoires d’action, mais également les interdépendances inhérentes aux objectifs de transition. Si l’on ne peut pas se représenter ces systèmes interterritoriaux, alors comment les accompagner et les renforcer, notamment du point de vue de l’État ?
Planification et pluriannualité : se donner les moyens de l’avenir
Johanna Rolland, Frédérique Bonnard Le Floc’h et Jérémy Camus ont replacé l’enjeu des moyens au cœur de la démarche de planification, dès lors qu’elle entend se concrétiser et ne se limite pas à une scène de dialogue. À ce titre, comme l’a rappelé Frédérique Bonnard Le Floc’h, les CRTE restent l’expression d’un projet sans engagement financier, et donc sans capacité réelle de concrétisation. Un enjeu partagé par Jérémy Camus, témoignant de la difficulté des territoires urbains à bénéficier du phénomène de financements « en cascade », et qui en arrivant sur le territoire ne correspondent plus aux enjeux faut de réelle co-construction des objectifs. L’un des enjeux, et donc des critères de jugement, de la planification écologique : adosser les moyens aux discours.
L’enjeu de la fiscalité a été régulièrement cité également : Johanna Rolland a ainsi appelé la communauté des chercheurs à se saisir des enjeux fiscaux de lutte contre l’artificialisation des sols. Comment préserver des sols riches et vivants alors que le modèle fiscal local incite par construction à artificialiser ?
Un questionnement plus global, dans un contexte de décentralisation annoncé, sur la nécessaire reconnaissance de capacités d’actions territoriales au bénéfice et par l’engagement de toutes et de tous. Une dynamique à laquelle le programme « POPSU Transitions » continuera, comme il l’a toujours fait, de contribuer par la puissance de son modèle : celui du dialogue perpétuel, de la recherche-action, du compromis et pas du consensus.