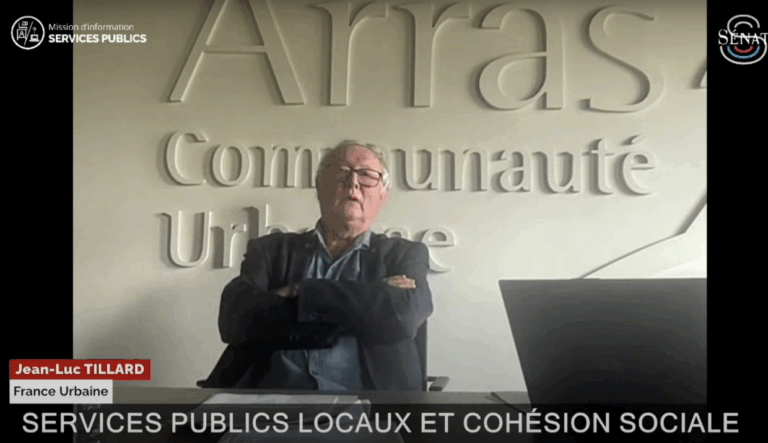ÉCOLE POUR TOUS : FACE À LA CARENCE PERSISTANTE DE L’ÉTAT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 27 MAI 2024, LES VILLES DEMANDENT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS
La loi du 27 mai 2024 prévoit la reprise en gestion par l’Etat des Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sur temps méridien, auparavant employés par les collectivités. En dépit des précisions apportées sur l’évaluation des besoins, un certain flou persiste. Face à l’absence d’application de la réforme, plusieurs villes déposent des demandes préalables indemnitaires susceptibles de préfigurer un recours contentieux.

Un cadre juridique récemment précisé mais générateur d’incertitudes
La mise en œuvre de la loi du 27 mai 2024, dite loi « Vial » a connu une certaine hésitation. France urbaine avait salué l’instruction détaillée parue courant 2024 reconnaissant le rôle des villes dans la stratégie de recrutement et l’évaluation des besoins.
Dans un contexte où la moitié des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) n’émettaient aucune préconisation sur temps méridien, cette instruction donnait à voir la complexité des processus d’évaluation et l’impératif d’une approche pluridisciplinaire s’appuyant sur l’ensemble des professionnels et sources disponibles.
Alors que le décret n° 2025-137 du 14 février 2025 n’apportait aucun complément, l’abrogation de l’instruction a laissé les collectivités dans l’incertitude. La foire aux questions parue en septembre, n’a fait in fine que dupliquer l’instruction initiale tout en fragilisant voire supprimant les conventionnements locaux mis en place.
Cette dernière apporte toutefois une innovation en mettant en place une fiche navette permettant l’évaluation des besoins soumis ensuite à validation du rectorat après avis de la collectivité. De même, les nouveaux textes parus – Circulaire du 1er septembre 2025 relative au déploiement des pôles d’appui à la scolarité (PAS) – reconnaissent le rôle des villes.
Cette reconnaissance de principe dans les textes constitue une avancée. Elle n’est toutefois pas pleinement assurée dans les faits.
Une carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre de la loi du 27 mai 2024
En juillet 2025, France urbaine présentait les résultats d’une étude flash lancée parmi ses adhérents. Elle donnait à voir une application inaboutie. Une forte proportion de territoires ne disposant d’aucun AESH Etat sur temps méridien, la carence observée est caractérisée et ne peut être justifiée par une divergence dans l’évaluation des besoins.
Les courriers adressés par certaines villes dès 2024 au rectorat, aux ministres en charge voire au premier ministre n’ont pas été suivis d’effet. Constatant l’absence de réponse de l’Etat, la ville de Toulouse a adressé ces dernières semaines une demande préalable indemnitaire. Une démarche identique pourrait être engagée par la ville de Marseille. Les sommes avancées sont estimées à près de 3 millions d’euros par la ville de Marseille et 1,8 millions d’euros par la ville de Toulouse.
En dépit d’une augmentation continue des effectifs d’AESH ces dernières années, les tendances observés en 2024-2025 se confirment au risque de confronter les familles à un dilemme : assurer le temps méridien au détriment du temps scolaire dans un contexte où les enveloppes ne couvrent pas les besoins et où les recrutements ne sont pas assurés sur les postes existants.
Vers un nouveau modèle de coordination à l’échelle nationale et locale
Une telle problématique fait écho aux travaux actuellement engagée à l’Assemblée nationale par la Commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la société. La présidente Nicole Dubré-Chirat et le rapporteur Sébastien Saint-Pasteur déplorent ainsi un suivi complexe de l’application des lois face à l’absence de données permettant de déterminer le niveau réel de scolarisation des élèves – une scolarisation de quelques heures ne répondant pas nécessairement aux objectifs fixés par la stratégie de désinstitutionnalisation engagée ces dernières années.
Les constats opérés par la présidente de France urbaine dans son courrier d’interpellation du 29 janvier 2025 à destination d’Elisabeth Borne, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche restent d’actualité.
« À l’occasion de la Conférence nationale du handicap, l’objectif d’une école pour tous a été réaffirmé. De nombreux efforts ont été réalisés. Nous nous en félicitons. La cible est claire. Nous la partageons. Le manque d’anticipation sur la trajectoire toutefois est vecteur de tension et d’épuisement pour les familles, les collectivités et les professionnels. Les difficultés dans la mise en œuvre de la loi du 27 mai 2024 actant la reprise en gestion par l’État, dès la rentrée 2024, des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sur temps méridien ont mis en lumière des problématiques de moyens et de coordination préexistantes qui n’ont fait que croître sous l’effet de l’augmentation du nombre d’enfants présentant des besoins particuliers avec ou sans notification dans le premier degré. Face à l’absence d’évaluation partagée des besoins et d’anticipation sur les moyens dans les zones le plus tendues, de nombreux territoires interviennent aujourd’hui en substitution. Le «tout AESH» ne saurait être une réponse aux enjeux de l’école pour tous mais le retrait de moyens non programmé et non coordonné non plus. »
L’école pour tous appelle une révision en profondeur des coopérations locales et invite à programmer sur le temps long aussi bien la mutation des pratiques professionnelles que du patrimoine scolaire.
Dans ce contexte de tension, de nouveaux modèles de coopération locaux émergent susceptibles de rénover le partenariat entre Education nationale et collectivités : détection précoce en petite enfance et passerelle entre crèche et premier degré (Versailles), médecine scolaire déléguée comme pivot d’une stratégie d’accompagnement global (Lyon), déploiement d’un modèle d’évaluation pluridisciplinaire des besoins (Toulouse).
À Toulouse, un protocole d’expertise pour évaluer les besoins des enfants sur temps méridien a ainsi été récemment travaillé entre le service départemental de l’école inclusive (SDEI) et la cellule inclusion-handicap de la ville. Les directeurs d’écoles, en équipe éducative évalueront les besoins en associant les familles et le périscolaire afin d’aboutir à un volume horaire d’accompagnement qui sera soumis au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) et SDEI pour validation.
Une prochaine étape résiderait dans la consolidation et la généralisation de ces modèles coordonnés et leur extension aux enjeux bâtimentaires en vue de croiser pleinement compensation et accessibilité (instituts médico-éducatifs dans les murs, espaces de répit…). Une présence renforcée des territoires urbains dans les gouvernances existantes (schémas départementaux des services aux familles, comités départementaux de suivi de l’école inclusive, observatoire des besoins) et une meilleure intégration des enjeux éducatifs dans les nouveaux outils en cours de déploiement (service public départemental de l’autonomie) pourraient y contribuer.