FRANCE URBAINE ENGAGE UN CYCLE DE TRAVAIL SUR L’ERRANCE, LES ADDICTIONS ET LA SANTÉ MENTALE
L’errance et les conduites addictives, souvent liées à des troubles de santé mentale, s’imposent aujourd’hui comme une préoccupation centrale pour les grandes villes et agglomérations. Pour mieux comprendre ce phénomène et accompagner ses membres, France urbaine a ouvert le 26 septembre un cycle d’auditions réunissant experts et institutions.
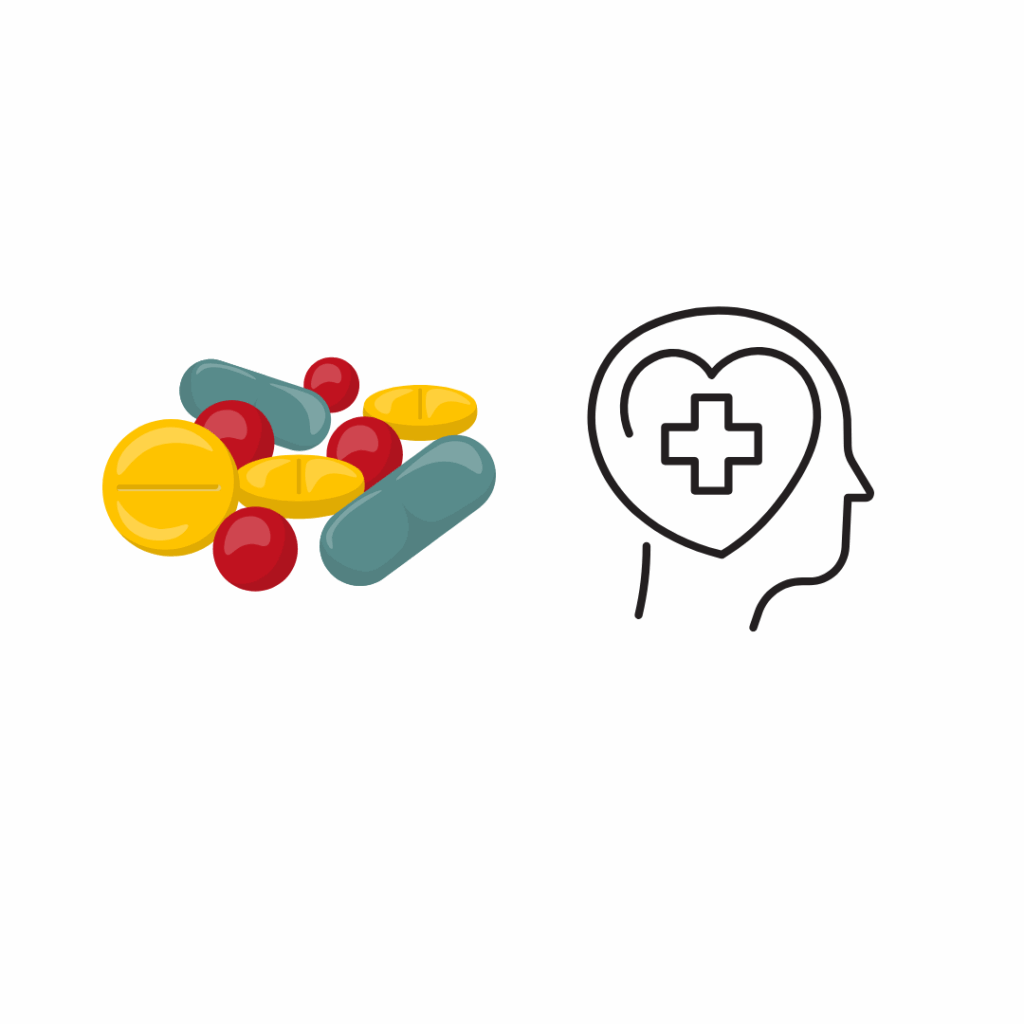
Ce sujet, qui touche à la fois la santé, la sécurité, le logement et l’action sociale, met en tension l’ensemble des services municipaux et intercommunaux. Depuis la crise sanitaire, l’augmentation des situations de vulnérabilité révèle à la fois l’insuffisance de l’offre de soins psychiatriques, la fragilisation de la santé mentale, en particulier des jeunes, et les limites des dispositifs de prise en charge existants. Les élus locaux se trouvent souvent en première ligne, interpellés par les habitants comme par les acteurs de terrain, sans toujours disposer des outils pour répondre à cette demande croissante.
Suite à un échange en Conseil d’administration, les commissions Santé, Solidarités et Sécurité-Prévention de France urbaine se sont saisies du sujet et lancent un cycle de travail, qui se traduira notamment par une série d’auditions d’experts et de professionnels jusqu’en janvier 2026. Trois finalités guident cette démarche : établir un diagnostic partagé, recenser les initiatives locales et définir une stratégie de plaidoyer nationale.
Une première audition consacrée aux enjeux sanitaires
La séance inaugurale a donné la parole à la MILDECA, à la délégation interministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie, ainsi qu’à la Fédération Addiction. Les intervenantes ont rappelé des données clés : près de 13 millions de Français vivent avec un trouble psychique, et 30 % de la population est concernée au cours de sa vie. Parmi les publics précaires, la proportion atteint 50 % — et 80 % si l’on inclut les problématiques d’addiction.
Ces éléments invitent à nuancer certaines représentations : moins de 2 % des actes pénalement répréhensibles sont commis par des personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique décompensée. L’errance et les troubles de santé mentale doivent ainsi être analysés d’abord comme des vulnérabilités médicales et sociales, et non comme une menace immédiate à l’ordre public.
Des leviers identifiés : prévention, décloisonnement, territorialisation
Les échanges ont mis en avant plusieurs pistes structurantes (1), avec différentes finalités :
- développer les actions d’« aller-vers » avec des équipes mobiles pour agir en amont et éviter l’hospitalisation,
- renforcer l’articulation entre hébergement et soin, encore trop lacunaire,
- décloisonner les financements pour permettre des parcours fluides,
- mieux former les professionnels de premier recours (médecins généralistes, acteurs sociaux),
- agir sur les déterminants de santé mentale (logement, emploi, discriminations), qui pèsent davantage que les seuls facteurs médicaux.
La question de l’articulation avec les départements, notamment autour de la protection de l’enfance ou du financement des structures sociales, a également été soulignée.
Le rôle des élus locaux
Au-delà de leurs compétences directes, les élus assument une fonction d’ensemblier : ils agrègent les acteurs, repèrent les situations et favorisent la coordination. Urbanisme, logement, culture ou sport sont autant de leviers locaux qui influent sur la santé mentale et l’inclusion sociale. Les coprésidents des commissions de France urbaine – Grégory Doucet, David Marti et Mathieu Klein – ont insisté sur la nécessité de porter cette approche transversale, qui seule permet de répondre à un phénomène multiforme.
Prochaines étapes
Le cycle se poursuivra dans les prochains mois avec trois nouvelles auditions portant sur la place des autorités régaliennes, l’accompagnement social et la place des sociétés face à ce phénomène de l’errance et des addictions. Les travaux aboutiront début 2026 à une série de recommandations et à une position nationale de France urbaine.
1. Exemples d’actions structurantes
« Un chez soi d’abord » et « Un chez soi d’abord jeunes » : permet un accès direct des personnes sans domicile présentant des pathologies psychiatriques sévères au logement en diffus dans la cité moyennant un accompagnement intensif et pluridisciplinaire – 39 sites sont ouverts pour un total de 3 175 places dont 220 dédiées aux jeunes
Plan Crack, Paris, depuis 2019
Gouvernance renforcée (PRIF, PP, Mairie, Procureur, ARS, RATP, AP-HP, GHU-PPN, MILDECA)
Continuum de prise en charge, des maraudes médico-sociales à la prise en charge thérapeutique hospitalière en passant par divers dispositifs de mise à l’abris (espace de repos, etc.)
Dispositif d’orientation des consommateurs vers des structures en addictologie en région
Dispositif ASSORE – accompagnement social et aux soins, orientation réinsertion ensemble – financé par l’Etat
En parallèle, mobilisation des services de police et de justice pour lutter contre les trafics (GPO crack)
Dispositif TAPAJ – travail alternatif payé à la journée
70 territoires –> les collectivités jouent un rôle clé en proposant des chantiers
Public : 16-25 ans marginalisés poly consommateurs
Accès direct à une activité rémunérée (payement en liquide à la fin de la journée), associé à un accompagnement médical, social et administratif
Intégré dans différentes politiques publiques : Pacte des solidarités, financement FLCA (10M€ prévus pour la période 2024-2027)
Equipe mobile addiction – Communauté de communes Provence Verdon
Equipe mobile addictions auprès des jeunes précaires en errance
Multi partenarial : préfecture, MILDECA, Communauté de communes, Fondation Apprenti d’Auteuils, Provence Verte Solidarité (association spécialisée en addictologie)
Travail de repérage menés par les partenaires et mise en œuvre d’une évaluation globale
Parcours de prise en charge des jeunes par une équipe pluridisciplinaire sur 6 mois
Action démarrée fin 2024 en cours de déploiement.
Accompagnement du public en protection maternelle et infantile, des mineurs et familles prises en charges dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance
Appel à manifestation d’intérêt du FLCA – 35 départements soutenus entre 2020 et 2024
Enjeu de formation des professionnels des structures
2. Références
Présentation de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
Présentation de la Délégation interministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie
Existence de guides et de formations à l’attention des élus : Psycom, Centre national ressources des CLSM du CC-OMS, Réseau des Villes santé, association « Elus, Santé Publique et Territoires » à l’origine de l’Appel de Nantes de 2022 en faveur de l’engagement dans la santé mentale, ARS
Bilan 2024 de la feuille de route nationale (FDR mai 2025) :
MKT-Tour de France Sante mentale-PTSM.indd
Synthèse du bilan 2024 de la FDR :
synthese_bilan-fdr-sante-mentale-psychiatrie.pdf
Rapport du Tour de France 2024 sur les PTSM :
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_tour_de_france_ptsm.pdf
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_tour_de_france_ptsm.pdf
Se renseigner dans le CAARUD le plus proche – carte disponible sur drogues-info-service.fr
Voir les rapports TREND de l’OFDT, dont leur déclinaison régionale (centres à Lille, Paris, Metz, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Etang-Salé)
Publication de l’observatoire européen des drogues et des toxicomanies – guide « sans-abrisme et drogues : réponses sanitaires et sociales », 2022