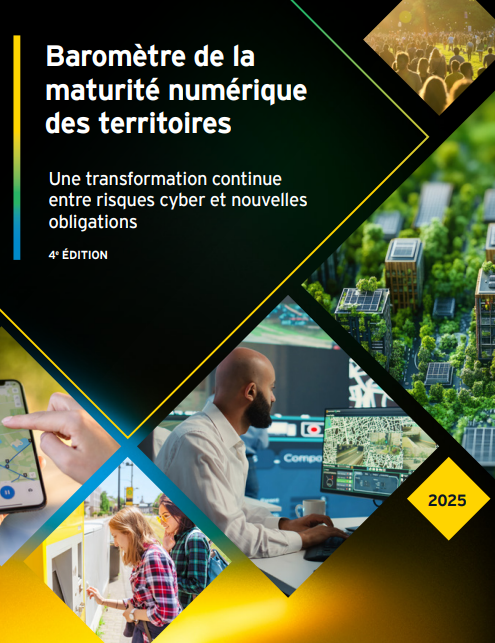DATA CENTERS : ENTRE MIRAGE TECHNOLOGIQUE ET CHOIX DE SOCIÉTÉ, LES TERRITOIRES À LA CROISÉE DES CHEMINS
Longtemps perçus comme des installations techniques secondaires, énergivores et peu désirables, les data centers connaissent aujourd’hui une réhabilitation spectaculaire. Relancés par l’essor de l’intelligence artificielle et les impératifs de souveraineté numérique, ils se voient dotés d’une nouvelle fonction stratégique : celle de catalyseurs d’une attractivité territoriale supposée renouvelée. Ils prennent position, aux côtés des gares TGV ou universités d’excellence, dans les infrastructures fondamentales à l’attractivité des territoires.

Le data center : d’infrastructure logistique à objet politique
À l’heure où les annonces d’investissements se succèdent – 6,4 milliards d’euros de Prologis en Île-de-France, 100 millions de Cisco, plus de 300 millions d’Amazon en région – les data centers quittent leur statut de « supplétifs numériques » pour incarner les promesses d’une « nouvelle géographie économique ». Mais derrière l’effet d’aubaine se dissimule une réalité plus contrastée : que produit réellement un data center pour son territoire d’accueil ? Quels sont les bénéficiaires, les coûts invisibles, les arbitrages nécessaires ?
Pour commencer à répondre à ces questions et constituer progressivement une nouvelle “boîte à outils” à l’attention de ses adhérents, France urbaine, en partenariat avec les Interconnectés et Intercommunalités de France et avec l’appui d’EY, a récemment organisé une journée de travail et d’échanges réunissant experts et praticiens du sujet. Premiers retours…
La territorialisation du cloud : entre urgence numérique et déficit de débat public
Le mouvement de territorialisation du cloud se fait aujourd’hui à marche forcée. À l’échelle de la France, plus de 600 sites sont déjà en activité – bien au-delà des 300 généralement évoqués – avec une dynamique exponentielle de création de nouveaux projets, notamment liés à l’IA.
Ce déploiement s’inscrit dans un double impératif :
- Technologique, avec des besoins accrus en traitement de données, latence réduite, sécurisation des flux ;
- Géopolitique, dans un contexte de montée des tensions sur la souveraineté numérique et la maîtrise des infrastructures critiques.
Mais cette dynamique s’accompagne d’un déficit de lisibilité pour les élus et acteurs publics locaux. Derrière l’acronyme « DC » (data center), se cache une grande hétérogénéité : des mini-centres intégrés à des sites hospitaliers aux méga-structures de 20 hectares en colocation, connectées directement aux autoroutes de la donnée mondiale.
À ce stade, les collectivités sont rarement associées aux décisions stratégiques d’implantation, alors qu’elles en supportent les impacts les plus directs : pression sur le foncier, consommation électrique, gestion de l’eau, transformation du paysage urbain ou périurbain. Sans parler de l’acceptabilité par les riverains…
Une économie en trompe-l’œil ?
La filière pèse aujourd’hui près de 5 milliards d’euros de valeur ajoutée et affiche une croissance sept fois supérieure à celle du PIB national. Mais à y regarder de plus près, les retombées locales restent modestes et difficiles à qualifier :
- Moins de 30 000 emplois directs sur le territoire national.
- Des fiscalités captées de manière inégale (avec de grandes disparités entre communes et EPCI).
- Peu d’effet d’entraînement documenté sur le tissu productif local, contrairement à d’autres infrastructures structurantes comme les ports, gares ou réseaux de transport.
Le pari de l’attractivité territoriale par les data centers reste donc à démontrer, et suppose d’ouvrir un débat démocratique sur les contreparties, les formes d’intégration possibles et les modèles à privilégier. Il s’agit d’interroger le data center comme équipement d’intérêt public, justifiant si nécessaire une mobilisation ad hoc de la collectivité.
Faire des data centers un levier d’aménagement maîtrisé
Face à cette mutation silencieuse mais décisive, France urbaine appelle à dépasser l’approche technicienne pour poser des choix de société clairs et faire des data centers un sujet politique. Doit-on accepter partout, sans condition, des projets énergivores, souvent déconnectés des usages locaux ? Ou peut-on inventer un modèle français du data center, à la fois sobre, réversible, utile et démocratiquement débattu ? Dimensionné selon les besoins et disponibilités des territoires. Et, pourquoi pas, positionné et déployé à l’initiative du territoire.
Cela implique :
- Une cartographie publique et transparente des infrastructures existantes et des besoins réels.
- Une planification spatiale et énergétique alignée avec les stratégies locales (réseaux de chaleur, densités urbaines, mix énergétique).
- Une gouvernance plus ouverte, incluant les élus, les citoyens et les partenaires techniques dans les processus de décision.
Conclusion : du consentement éclairé à l’action publique
Les data centers sont devenus les cathédrales modernes du numérique. Mais leur généralisation ne peut se faire sans débat ni cadre. Pour éviter que nos territoires ne deviennent les zones de servitude passive de la mondialisation des données, il est temps de construire une doctrine collective : celle d’un numérique utile, partagé, responsable et ancré localement.
France urbaine poursuivra avec ses partenaires cette réflexion dans les prochains mois, notamment à l’occasion du Smart Cities World Congress de Barcelone, en lien avec ses partenaires européens. D’autres ateliers et études de cas sont également en préparation.