SANTE SCOLAIRE : VERS LA RECONNAISSANCE ATTENDUE DES VILLES DELEGATAIRES ?
Publication du rapport d’information sénatorial « Une démarche novatrice, des pistes pour réformer la santé scolaire »
La Délégation aux collectivités territoriales du Sénat a récemment rendu public un rapport d’information, présenté sous forme d’étude d’option, intitulé « Une démarche novatrice, des pistes pour réformer la santé scolaire ».
Un rapport utile, précis et qui trace des perspectives de dialogue et d’action importantes, porté par les sénateurs Bernard DELCROS, Président de la délégation aux collectivités territoriales et sénateur du Cantal, et Hervé RAYNAUD, Sénateur de la Loire.
Dans le cadre des travaux, France urbaine avait pu être auditionnée le 30 octobre 2024, représentée par Stéphanie Léger, Adjointe au maire de Lyon en charge de l’éducation, et Pierre-André Juven, Adjoint au maire de Grenoble en charge de la santé.
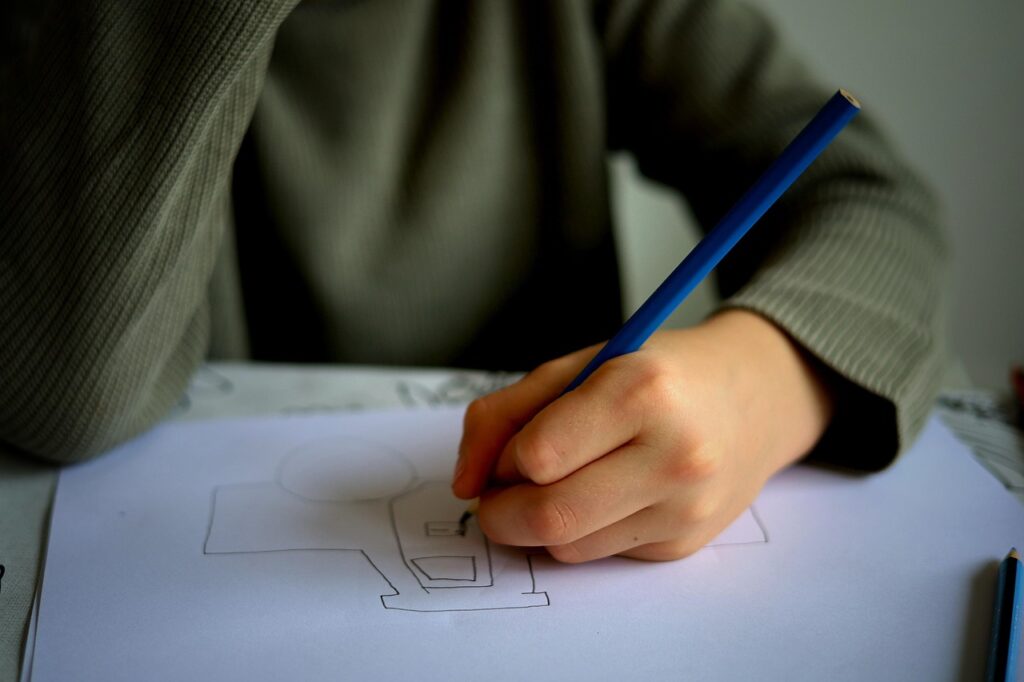
Un rapport pour éclairer les travaux législatifs
L’origine de ce rapport tient en grande partie à l’initiative législative importante impulsée et portée par Françoise GATEL, alors présidente de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et aujourd’hui Ministre de la ruralité, qui avait abouti le 20 mars à l’adoption par le Sénat d’une proposition de loi visant à « expérimenter le transfert de la compétence santé scolaire aux départements ».
De fait, et comme le soulignent les rédacteurs du rapport, « la santé scolaire en effet défaillante ». Consolidant diverses sources (rapports et études parlementaires notamment), le texte rappelle utilement la réalité des chiffres, et donc la réalité du déficit d’accompagnement des enfants : « chute de plus de 28 % de l’effectif des médecins scolaires depuis 2013 », « taux d’encadrement d’un médecin pour 12 800 élèves et d’un infirmier pour 1 303 élèves », « moins de 20 % des élèves [ayant] bénéficié de la visite médicale, pourtant obligatoire, en classe de sixième », alors même que « les troubles dépressifs ont été multipliés par deux chez les adolescents, les tentatives de suicide ont augmenté de 63 % chez les 10-14 ans et de 42 % chez les 15-19 ans » Un sujet qui nécessité une prise de conscience et une mobilisation urgente alors que la santé mentale est maintenue comme « Grande cause nationale pour 2025 » et que France urbaine en fera l’un des fils rouges de ses travaux pour l’année à venir .
Une réalité à laquelle « s’ajoute le recensement de plus de 700 000 cas de harcèlement scolaire » à ce titre, France urbaine avait d’ores et déjà pu passer des messages dans le cadre de la « Mission flash sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » publiée par les députées Soumya Bourouaha et Virginie Lanlo le 29 mai 2024.
La reconnaissance longtemps attendue de l’action efficace des communes délégataires de l’Etat en santé scolaire, et jusque-là trop méconnue
Face à ces enjeux, et comme le soulignent les rapporteurs, l’étude d’options « a le mérite de faire émerger dans le débat un sujet qui ne figurait pas dans le texte examiné par le Sénat en mars 2024 », c’est-à-dire l’engagement et l’efficacité des communes délégataires en santé scolaire dans le cadre notamment d’une convention conclue avec l’Etat : Antibes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Nantes, Rennes (dans le cas particulier d’une convention avec la protection maternelle et infantile), Grenoble, Paris, Strasbourg, Vénissieux et Villeurbanne.
Des modèles efficaces, puisque citant la Cour des Comptes, les sénateurs rappellent les meilleurs taux de réalisation de visite médicale pour les enfants dans leur sixième année. Des modèles intégrées et pluridisciplinaires aussi, qui trouvent une grande partie de leur efficacité dans la mise en lien des acteurs et des professionnels au service du parcours de l’enfant.
Une réalité d’ailleurs rappelée par le sénateur Hervé RAYNAUD, invitant « à parler de « santé scolaire » plutôt que de « médecine scolaire ». En effet, « la santé scolaire est un concept plus global puisqu’il comprend non seulement la médecine scolaire, mais aussi toutes les actions destinées à promouvoir le bien-être des élèves et l’amélioration de leurs conditions de vie en milieu scolaire ».
Un gage d’efficacité pour les publics, mais aussi pour l’approche recherchée par le Sénat de « sobriété et d’efficacité normatives, en ce qu’elle est susceptible d’inclure, en étant moins restrictive, d’autres évolutions à venir dans le domaine de la santé de l’enfant en milieu scolaire. »
La nécessité de ne pas fermer la porte à d’autres villes qui souhaiteraient s’engager, sur la base du volontariat, dès lors que les bases financières sont clarifiées
« Les villes délégataires semblent donc plus efficaces que l’Éducation nationale. Mais ce volontarisme local représente un coût important pour les communes concernées ». Citant les données obtenues grâce aux échanges avec France urbaine, le rapport rappelle plus qu’utilement l’absence de compensation réelle de la part de l’Etat : « le coût de la prise en charge s’élève, pour ces communes, à près de 40 euros par enfant et par an, alors que l’État verse une subvention moyenne de 9,50 euros aux onze villes gestionnaires du service de médecine scolaire ».
Une réalité qui entrave de fait l’engagement d’autres villes, sur la base du volontariat, malgré la performance reconnue du modèle. Car là encore, le mythe du jardin à la Française ne peut trouver à s’appliquer, et le rapport montre bien la diversité des hypothèses activables en fonction des spécificités territoriales.
Reste qu’en l’absence de participation de l’Etat, à la hauteur simplement de ses engagements sur le reste du territoire, l’élargissement des villes à d’autres volontaires reste théorique. Une réalité qui a poussé France urbaine et le Réseau français des Villes Santé OMS à se mobilier, dans le cadre de la plateforme PLFSS de France urbaine, pour tenter d’obtenir une meilleure compensation des villes délégataires, à hauteur de 10 millions d’euros pour 2025. Un combat qui continuera d’être mené.
D’où l’importance de l’ouverture permise par ce rapport, qui invite à prendre en compte l’hypothèse d’élargir l’expérimentation à d’autres communes, ou encore interroge les bienfondés respectifs des notions de délégation ou de transfert : des perspectives de travail rénovées, sur laquelle France urbaine pourra continuer à s’exprimer de manière constructive dès lors que les compensations financières sont à la hauteur des enjeux et que le principe de volontariat s’applique.
Des pistes de travail, pour continuer à avancer ensemble au service de la santé globale des enfants
France urbaine a toujours placé la santé des enfants et des jeunes au cœur de sa mobilisation et de ses propositions.
En présentant ses conclusions sous forme de scénarios et d’études d’options, ce rapport a également le grand mérite de d’ouvrir un certain nombre de questionnements qui pourront être discutés au sein de France urbaine :
- Quid du « regroupement [des fonctions des médecins scolaires] avec d’autres, dont celles de médecin de PMI et de médecin de centre municipal de santé, dans un métier de médecin de santé publique» de proximité relevant du statut de fonctionnaire » pour favoriser une revalorisation indiciaire ;
- Quid de la volonté de « décloisonner les différentes professions […] en vue de créer de véritables équipes pluridisciplinaires» qui pourraient déployer des « collaborations avec les équipes de santé présentes dans les territoires, à l’instar de ce qui existe dans le suivi de la scolarité des enfants qui présentent des troubles de l’apprentissage ou des handicaps »;
- Quid de l’amélioration de la coordination avec les acteurs externes et [de la réalisation] des diagnostics territoriaux partenariaux, tant à l’échelle des départements qu’à celle des EPCI, sans nécessairement créer de nouvelles structures administratives ou organisationnelles», un enjeu qui renvoie aussi aux propositions d’évolution du dialogue territorial en santé porté par France urbaine, pour une véritable reconnaissance de la responsabilité populationnelle urbaine.
- Quid de la nécessité de faire évoluer les « outils numériques permettant le partage des informations, ainsi que [le] pilotage et […] la remontée des données ;
- Quid de la nécessité de faire « reconnaître le savoir-faire de certaines infirmières ayant un parcours en pratique avancée serait une solution pour pallier le manque cruel de médecins dans certains territoires » ?
France urbaine restera mobilisée sur ces enjeux et sur le renforcement des capacités collectives d’action auprès des enfants.